Célèbre pour son travail de photographe et de vidéaste, l’artiste kazakhe Almagoul Menlibaïeva met en scène des modèles féminins semblant tout droit sortis d’un magazine de mode, dans un cadre qui évoque le Kazakhstan quasi-traditionnel : paysages de steppe, mur d’une mosquée, ruines de bâtiments industriels soviétiques. Transitory White s’est entretenu avec Almagoul Menlibaïeva de son art, du féminisme et du monde artistique kazakh.
Novastan reprend et traduit ici un article publié le 14 novembre 2019 par notre version allemande, lui-même traduit du média allemand en langue anglaise Transitory White.
C’est une artiste qui compte au Kazakhstan. Almagoul Menlibaïeva, née à Almaty en 1969, est une artiste vidéaste, photographe, et co-conservatrice du Focus Kazakhstan Berlin (2018). Elle est connue pour ses photographies, et ses œuvres mêlant photos et vidéos. Son travail porte sur les transformations sociales, économiques et politiques de l’ère post-soviétique en Asie centrale, la réinvention du genre dans la décolonisation, la dégradation de l’environnement, ainsi que les mythes nomades et indigènes eurasiens.
Soutenez Novastan, le media associatif d’Asie centrale
En vous abonnant à Novastan, vous soutenez le seul média en anglais, français et allemand spécialisé sur l’Asie centrale. Nous sommes indépendants et pour le rester, nous avons besoin de votre aide !
Dans le cadre de son exposition Transformation au Grand Palais de Paris (2016 – 2017), elle a reçu le titre de « Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres » de la ministre française de la Culture en 2017. Elle s’est également vue décerner le prix d’État « daryn » du Kazakhstan (1996) et le prix national « tarlan » du club de Maecenas du Kazakhstan (2003). Elle a été lauréate du Grand prix de l’art asiatique à la deuxième Biennale d’Asie centrale, à Tachkent, en Ouzbékistan (1995), et du Prix principal du Festival international du film « Kino der Kunst » (2013) à Munich, en Allemagne.
L’artiste combine ces éléments avec la nudité féminine et des objets tels que des cornes de chèvre, des renards morts ou des uniformes de police. Ainsi, ses œuvres racontent au public des histoires enchevêtrées : celle du totalitarisme, de la (dé)colonisation post-soviétique et du féminisme. Victoria Kravtsova, doctorante sur le féminisme et journaliste pour Transitory White, a rencontré Almagoul Menlibaïeva pour mieux comprendre son œuvre.
Transitory White : Almagoul, parlez-moi de vos origines. Où avez-vous grandi et étudié ?
Almagoul Menlibaïeva : Je suis née à Alma-Ata (l’ancien nom d’Almaty, ndlr) et j’ai étudié à l’Académie nationale des arts du Kazakhstan. La culture nomade m’a toujours intéressée, j’ai toujours vu ça comme un grand casse-tête. Je cherchais à comprendre : qu’est-ce que l’image ? Pourquoi doit-elle être contrôlée ? Ce n’est que récemment, quand j’ai commencé à réaliser des performances et des vidéos, que j’ai observé la sur-représentation des hommes dans cette sphère. On leur inculque un certain regard : les hommes apprennent à regarder les femmes comme des objets. C’était clair pour moi quand j’ai commencé ma carrière. Il y a eu quelques cas où mon travail m’a été volé. Alors j’ai simplement commencé à tout faire moi-même, y compris le tournage.
Considérez-vous cela comme un acte émancipateur et vous considérez-vous comme une féministe ?
Bien sûr, je me dis féministe, j’emploie ce mot maintenant. Pourtant, ça m’a pris du temps avant d’arriver à utiliser ce terme. Pendant longtemps, je ne l’employais pas, alors qu’en fait j’étais féministe. Je suis née dans une famille patriarcale plutôt traditionnelle, comme il y en a beaucoup au Kazakhstan. En fait, je dirais que toute l’URSS était patriarcale. C’est un sujet qui nécessiterait des recherches de notre part : la manière dont nous agissions à l’époque, quelles idées, quels postulats guidaient nos vies. J’ai personnellement rencontré des problèmes à la maison, dans la famille, à l’école, à l’université et aussi quand j’ai décidé de devenir artiste. Ça a toujours été clair pour moi : ces problèmes étaient liés au fait que je sois une femme. Je dois toujours fournir deux fois plus d’efforts que les hommes pour obtenir quelque chose. Alors bien sûr je me dis féministe, j’utilise ce terme. Les mots, ça vient toujours plus tard finalement.
Comment définiriez-vous votre féminisme ?
Je lis énormément, mais je ne vais pas me référer ici à des auteurs ou des théories. Il existe beaucoup de clichés sur le féminisme et personne ne peut agir parfaitement sans contradiction. Proposer des opinions et des descriptions multiples et variées du féminisme, c’est un moyen possible pour le transformer en un concept dans lequel tout le monde puisse se retrouver.
Lire aussi sur Novastan : Paroles de féministes et militants LGBT au Kazakhstan
Mon féminisme doit être parfaitement en phase avec mes idées. Sans forcément citer des théoricien.ne.s, j’ai en tête des artistes féminines de différentes nationalités – et leur façon de coloniser ou de libérer l’image. J’aime Marina Abramović, j’aime les féministes racisées d’Afrique, de Cuba. Nous ne pouvons pas laisser le féminisme rester cette version élitiste « propre ». Elle doit être multiple et proposer quelque chose à tout le monde. Nous devons élargir les objectifs pour que plus d’hommes et de femmes possibles soient concernés. Nous devons faire en sorte que ce mot soit partout.
Existe-t-il un féminisme spécifique à l’Asie centrale ?
Il me paraît étrange de parler de l’Asie centrale comme un tout, c’est un ensemble de pays et de nations très divers. Je suis plutôt opposée au fait de distinguer une zone géographique particulière et de souligner la spécificité d’une région, d’un pays ou d’un groupe de pays, car cela mène à généraliser. Je suis davantage pour des stratégies individuelles, propres à chaque cas concret : à qui suis-je en train de m’adresser ? Vais-je être comprise immédiatement ?

Puisque vos œuvres d’art se réfèrent aux thèmes de la colonialité et du genre, vous devez avoir conscience que la frontière est mince, entre l’autonomisation d’un côté, l’objectivation et l’exotisme de l’autre. Où s’arrête cette frontière ? Avez-vous connaissance d’objections à votre travail ?
Je peux imaginer que certains y voient de l’exotisme, ça n’a jamais été mon cas. Ça a été une quête de ma propre identité. J’ignorais qui j’étais durant de nombreuses années, j’ai grandi dans une famille russophone, je connaissais la culture russe, mais rien sur la mienne. Et un jour, j’ai commencé à l’explorer. Alors que j’avais environ 4 ans, un évènement s’est produit : je reçois une poupée en cadeau et ma grand-mère la brûle. Pourquoi a-t-elle fait cela ? Car elle pensait que la poupée était inappropriée. Pourquoi préserver l’image était-il alors si important ?
Pendant mes études d’artisanat et d’arts décoratifs, j’ai compris comment circulent et se transforment des idées dans les différentes cultures ; à présent, je continue d’explorer la manière dont l’identité se reflète dans les images visuelles. Par exemple, ce motif que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de paisley – il vient en fait du Nord, des dessins des tribus sibériennes. Il a ensuite voyagé vers l’Est, jusqu’aux cours royales. Chaque empire garde en lui des éléments des peuples colonisés, la migration des savoirs en est un exemple actuel, bien qu’elle suscite peu de réactions.
Or, une grande partie de ce qui est absorbé par la colonisation appartient d’abord aux femmes, parce que l’artisanat est leur domaine. Dans les aires au passé soviétique, la question du « national » a été tabou pendant très longtemps, elle revient donc d’autant plus sur le devant de la scène aujourd’hui. En URSS, le « national » est avant tout une construction de l’État. Par exemple, dans le passé, il existait 30 à 40 costumes nationaux différents. Les Soviétiques n’en ont sélectionné qu’un, pour symboliser le « patrimoine » et l’« authenticité ». On nous a légué des stéréotypes, et désormais nous devons tous travailler avec.
Il existe un phénomène intéressant dans de nombreux pays post-soviétiques, dont la Russie et le Kazakhstan. Alors que la politique officielle de l’URSS était athée, avec des terres confisquées aux églises et des persécutions contre les chefs religieux, la situation a radicalement changé après la dissolution de l’Union soviétique. Est-ce lié à la recherche de l’identité, à la volonté d’appartenance à une autre forme de communauté, ethnique ou territoriale ?
Pourquoi l’espace post-soviétique est-il devenu religieux ? Pour combler le vide qu’a créé la chute du totalitarisme. Personne n’est venu réinventer et refonder la conscience totalitaire que nous avions à l’époque. Puis, dans les années 1990, qui a été une période très difficile, les gens se sont, sans surprise, raccrochés à la religion. Et le passé, l’héritage du matérialisme était encore bien présent. Finalement, nous avons hérité d’une forme de religiosité matérialiste.
Encore une fois, les femmes ont le plus souffert. La religion opprime d’abord les femmes. Les hommes ne sont pas les seuls coupables, nous sommes tous coupables, les femmes aussi, les femmes nous élèvent et font de nous ce que nous sommes. Les femmes ont une position très ambivalente, elles sont à la fois oppresseurs et opprimées.
J’essaie de représenter cette dualité dans mon travail. De refléter mes observations. Je crois que la culture est un moyen de communiquer à travers la souffrance humaine, et cette communication est une fonction de l’art. L’art a sa place en politique, dans le journalisme, il ne peut pas se cantonner aux musées. Mon art est ma façon de communiquer mes idées, et je crois que mon langage est adapté à ce que je veux exprimer.
L’exposition Bread and Roses, que vous avez organisée en 2018, tire son titre du poème de James Oppenheim écrit en 1911. Le poète prédisait alors le succès des grèves menées par les travailleuses du textile aux États-Unis, qui se dérouleraient effectivement un an plus tard. Par sa référence aux luttes féministes et celles de la classe ouvrière, le titre est intrinsèquement politique. Or, en URSS, ces luttes s’inscrivent dans une histoire de politique coloniale qui a cherché à effacer l’identité nationale et ethnique…
Cette exposition portait sur l’URSS en tant qu’unité féodale, sur l’esclavagisme, sur le colonialisme et sur la manière dont la modernité soviétique a privé les gens de nationalité. Les questions de genre étaient également abordées. J’ai interviewé les femmes qui se sont fait violées dans les camps de Karlag pour comprendre comment cela était alors normalisé, pour montrer que les femmes soviétiques n’avaient pas été libres. Nous avons cherché à explorer les possibilités d’expression de la femme soviétique au sein du système et à comprendre à quel point la répression était liée au genre et à la sexualité.
J’ai travaillé avec l’État, je crois que nous avons le droit d’exiger des choses de lui. Il faut aussi que l’État soit prêt à communiquer. Notre exposition abordait le féminisme de manière indirecte, alors que l’idée majeure était bien le féminisme. Pour certaines personnes à l’heure actuelle, il est impossible de dire « je suis féministe ». Yekaterina Kuznetsova m’a raconté une histoire intéressante au sujet du camp de Karlag. Staline y envoyait les femmes de ses bureaucrates. Ses hommes devaient choisir : leur femme ou leur chef. Voilà sous quelle forme s’exerçait le pouvoir au sein de la sphère masculine. La perspective du genre éclaire parfois des récits sous de nouveaux angles.
Ecrit par Viktoria Kravstova
Journaliste pour TransitoryWhite
Traduit de l’allemand par Flora Perez
Edité par Anne Pouzargues
Relu par Anne Marvau
Merci d'avoir lu cet article jusqu'au bout ! Si vous avez un peu de temps, nous aimerions avoir votre avis pour nous améliorer. Pour ce faire, vous pouvez répondre anonymement à ce questionnaire ou nous envoyer un email à redaction@novastan.org. Merci beaucoup !
 « L’art a sa place en politique, il ne peut se cantonner aux musées », entretien avec Almagoul Menlibaïeva
« L’art a sa place en politique, il ne peut se cantonner aux musées », entretien avec Almagoul Menlibaïeva 
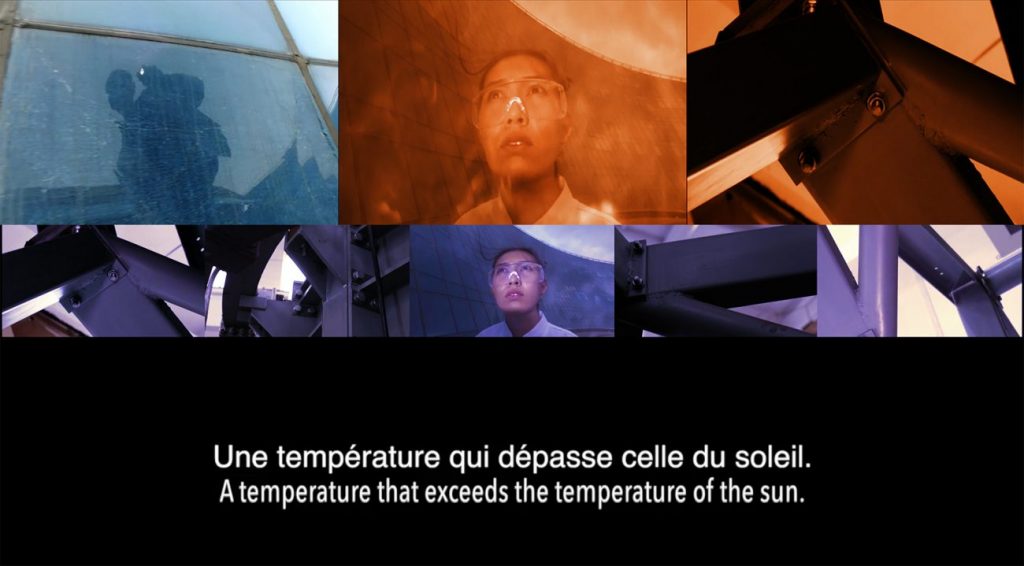



 Que retenir de la campagne du FC Kaïrat d’Almaty en Ligue des champions ?
Que retenir de la campagne du FC Kaïrat d’Almaty en Ligue des champions ?